KAIROS la troisième livraison.
 Un article sur Rio+20 : enterrement de 1re classe pour le développement durable, de Bernard Legros,
Un article sur Rio+20 : enterrement de 1re classe pour le développement durable, de Bernard Legros,
Les chroniques de :
Jean-Pierre L. Collignon, sur le sens réel de la découverte du Boson !
Paul Lannoye, sur l’arrivée de la « 4G », les grincheux, le progrès et les abeilles,
La Foire aux Savoir-Faire, qui propose une méthode pour embellir les murs, façon nature,
Gwenaël Breës, sur le StarCHystem,
Martin Pigeon, pour le Corporate Europe Observatory, sur les véritables pilotes de la crise.
Un dossier sur les méga-centres commerciaux, avec notamment un article de Paul Ariès. Dossier présenté ci-dessous,
Des brèves, recensions de films, lectures, annonces…
Pour soutenir Kairos c’est simple : abonnez-vous ou, comme le dit la formule : « achetez la presse libre pour qu’elle ne soit pas vendue » !
www.kairospresse.be
Dossier Kairos 3 :
Invasion de centre commerciaux, véritables aspirateurs
Un centre commercial est une pompe à euros au fonctionnement bien rôdé. Un promoteur construit une énorme espace de béton, aidé par les pouvoirs publics, y installe des magasins, le plus souvent des grandes chaînes, et en tire des revenus importants. Le centre commercial fait souvent l’objet de spéculations, est revendu, et chacun des protagonistes empoche de gros bénéfices. Le gestionnaire de la grosse boîte lui, tire des profits colossaux des dépenses de consommateurs orientés « à l’insu de leur plein gré » de manière à ce qu’ils y laissent le plus possible. Profits d’autant plus importants que le nouvel espace commercial implique généralement la ruine des petits magasins dans lesquels vous préfériez peut-être vous rendre avant. Vous connaissiez la boulangère, le boucher, le menuisier, le fripier, le libraire ? Vous irez au mall. Avant l’argent circulait localement de portemonnaies en échoppes nombreuses. Il ne reste plus qu’un énorme tuyau, celui du méga-centre commercial, la pompe à fric qui fait remonter vos économies dans quelques rares poches cotées en bourse.
Première aspiration.
Un méga-centre commercial, c’est aussi un acteur de déstructuration culturelle et symbolique qui renforce la dépendance de l’individu à un système hétéronome. C’est-à-dire que nous y contrôlons de moins en moins ce qui se joue devant nous, avec nous et par nous (nos consommations, nos déplacements, nos participations, nos envies – demandez une fois de parler à l’ouvrier qui a cousu vos chaussures pour savoir comment il va et comment il a réalisé votre godasse). Le méga-centre commercial nous désapprend à être collectivement autonomes, à nous débrouiller ensemble, à construire notre coexistence vivante. Il est le nouvel éden du consommateur qui après le dur labeur de la semaine, peut aller se détendre dans un lieu où l’opulence qui résulte de son travail - surtout celui des autres, là où l’exploitation est plus facile - s’expose dans l’excès ostentatoire des vitrines rassemblées dans le grand bloc de béton climatisé. Ici on rajoute verrières au plafond et arbres en plastique sur les travées pour donner l’impression de l’inclusion de la consommation dans la vie quotidienne : la consommation devient là plus qu’ailleurs la signification de toute la vie où l’on travaille pour consommer. Le méga-centre commercial, débouché logique du « progrès » des sociétés marchandes, est le trou noir du désir humain.
Deuxième aspiration.
Ajoutez à cela que le méga-centre commercial est le cauchemar environnemental et social mis en boîte : on s’y rend surtout en bagnole qui roule au pétrole irakien ou tchétchène, pour acheter des produits le plus souvent produits dans des conditions sociales proches de l’esclavage, qui ont fait le tour du monde et qui sont promotionnées dans des campagnes de pub débiles imposées à tous et toutes en tous lieux et en tous temps. Le personnel qui travaille dans les méga-centres commerciaux, duquel nous nous sentons solidaires, est souvent traité mal. Et nous craignions que cela empire avec le temps, puisque que la guerre des prix pour faire tourner la pompe à fric est menée malgré eux par les travailleurs.
Comment a-t-on pu inventer des horreurs pareilles ? Nos enfants se demanderont sans doute comment les habitants de notre époque auront accepté d’avaler les pseudos-explications pseudos-économistes qui tiennent lieu de justification à ces cauchemars de béton. Toujours est-il que ces objets pullulent.
Vous trouverez dans ce dossier des présentations de méga-centres qui existent déjà (à Mons) ou qui sont en préparation (Verviers, Namur, Bruxelles), présentations réalisées par ou grâce à des militants que nous remercions. Certains acteurs économiques, certaines pratiques, certains intérêts sont récurrents. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans d’autres numéros, pour suivre l’évolution des projets et vous donner de nouvelles informations. Paul Ariès propose une analyse critique du méga-centre commercial, et débouche sur des propositions politiques pour bien vivre. Une affiche illustrée en double-page centrale, de Chloé et Fanny illustre les propos et pourra, nous l’espérons, être détachée et utilisée comme support militant dans des manifestations diverses. Pour finir, le récit d’une action citoyenne exceptionnelle, menée contre l’implantation d’un méga-centre commercial à Verviers, pour une ville conviviale et vivante.
Et si vous voulez agir face à l’invasion des méga-centres, une inspiration, simple : chaque fois que possible, n’allez pas dans ces lieux indécents ! Bonnes lectures et actions.
Comment démanteler la méga-machine ?
 Publié sur Entropia, repris sur les-oc.info
Publié sur Entropia, repris sur les-oc.info
[Merci à Philippe Bihouix de nous permettre de reprendre cet article publié d'abord dans le numéro 12 de la revue Entropia]
Fukushima a été l’occasion cruelle de rappeler à tous les réalités intolérables de l’industrie nucléaire, et marquera sans aucun doute le coup d’arrêt de sa « renaissance » annoncée sous les auspices de la lutte contre le changement climatique et de l’arrivée imminente des pics pétrolier et gazier. Le débat sur la sortie du nucléaire progresse même en France, mais il reste enchâssé dans les aspects techniques de la substitution, possible ou non, à quel rythme et à quel coût, de la production électronucléaire par d’autres énergies.
Pourtant, démanteler les centrales nucléaires ne suffira pas à sortir de l’anthropocène, loin s’en faut. Car en fondant la sortie du nucléaire avant tout sur le développement massif des énergies renouvelables, nous nous bercerions des mêmes illusions que les plus farouches partisans du nucléaire : en particulier la croyance en la pérennité de notre système industriel, tel que nous le connaissons aujourd’hui. Or d’ici quelques décennies celui-ci aura vécu.
Prendre la vraie mesure de la transition nécessaire
Pourquoi en effet, selon nos brillants technarques, se lancer dans la construction ruineuse de centrales de troisième génération (type EPR) qui ne résolvent en rien les questions des risques ou des déchets, ni celle d’ailleurs des réserves de combustible, l’uranium 235 – qui à elle seule, n’aurait de toute manière pas permis un développement très fort de l’industrie nucléaire[1] ?
Un des arguments « rationnels » avancé est que le nucléaire pourrait – devrait ? – devenir, à terme, disons dans quelques dizaines d’années, une énergie propre et abondante dont l’humanité ne pourra se passer. Il serait ainsi nécessaire, presque coûte que coûte, de maintenir sous perfusion la filière afin de mener les recherches et d’acquérir les expériences industrielles qui permettront, dans un premier temps, vers 2040 ou 2050, de passer à la quatrième génération (les surgénérateurs), puis, à l’horizon 2100 peut-être, à la fusion, sans parler d’autres produits intermédiaires comme les mini-centrales sous-marines, forcément tellement pratiques et sûres.
La quatrième génération et les suivantes « mangeant » de l’uranium 238, du plutonium voire certains actinides, viendraient résoudre le problème des réserves, et d’une partie des déchets. Nous aurions, enfin, quelques milliers d’années devant nous. Quant à la fusion, le fantasme de l’énergie en quantité infinie et non polluante justifie les milliards engloutis dans ITER[2]. En résumé, il faudrait donc appuyer à fond sur la pédale de l’accélérateur, tout en serrant les fesses pour ne pas avoir trop de problèmes avec nos cocottes minute actuelles et à venir – car on nous le répète désormais à l’envi : il n’y a pas de risque zéro – en attendant un avenir meilleur et absolument propre.
C’est faire fi des aspects systémiques de notre société industrielle qui risquent fort de venir perturber ce charmant scénario. Pour ne prendre qu’un exemple, le développement du nucléaire est basé sur une formidable disponibilité en énergies fossiles et en métaux.
Compte tenu des conditions de travail sévères dans un réacteur nucléaire ou dans la filière des combustibles et des déchets, les matériaux utilisés doivent résister à la température, la pression, la chaleur, la corrosion, l’irradiation. On y trouve ainsi du nickel, du titane, du cobalt, du tantale, dans les aciers inoxydables et les alliages à haute teneur en nickel, très largement employés dans la robinetterie nucléaire ; du zirconium pour emballer les « crayons » de combustible ; du plomb pour ses capacités à absorber les radiations ; du tungstène pour les conteneurs de combustible nucléaire ; de l’hafnium, du cadmium, de l’indium, de l’argent, du sélénium, du bore[3], matériaux absorbeurs de neutrons utilisés dans les barres de commande et de contrôle ; du lithium, comme réfrigérant pour les réacteurs ou dissolvant de combustible nucléaire ; etc.
Pour toutes ces ressources minérales, nous disposons de 50 à 100 ans de réserves – et encore pour les plus abondants. Nous exploitons un stock géologique limité, qu’il ne sera possible d’augmenter péniblement à l’avenir qu’au prix d’une dépense énergétique exponentielle, parce que les ressources seront moins concentrées et/ou moins accessibles (plus profondes, sous-marines ou aux latitudes polaires). De la même manière que l’on épuise la planète à lutter contre le pic de pétrole conventionnel avec un rendement – Energy Return On Energy Invested – dangereusement décroissant[4], il faudra bientôt compter avec d’autres indicateurs, Metal Return On Energy Invested, Energy Return On Metal Invested, ou même Metal Return on Metal Invested.
Alors à quoi bon chercher – à grands frais et surtout grands risques – à développer des systèmes techniques qui nous apporteraient prétendument des milliers d’années de réserve d’énergie, puisqu’il faudra bien, fatigue oblige, renouveler les centrales, quel que soit leur type, au moins une ou deux fois par siècle, ce qui sera littéralement impossible puisque nous manquerons de métaux pour les construire, voire même pour maintenir l’ensemble du système technique (robotique, électronique, informatique, moyens de déplacement rapide pour experts ou techniciens spécialisés…) permettant leur exploitation ?[5] Car la contrainte géologique s’appliquera aussi aux métaux non spécifiques de l’industrie nucléaire, comme l’étain, utilisé pour les soudures électroniques.
Or, malheureusement, nous pourrions étendre ce même raisonnement aux autres énergies, à commencer par l’éolien de forte puissance et le solaire. Certes, avec la dimension du risque d’accident en moins, ce qui est déjà énorme !
Car sinon, quelle différence, en termes de contenu technologique, de complexité technique, entre une centrale nucléaire et une éolienne industrielle de 5 ou 7 MW, par exemple ? Ou plutôt, un macrosystème de milliers d’éoliennes et de « fermes » photovoltaïques, reliées par des smart grids permettant à tout instant d’équilibrer offre intermittente et demande variable ? Aucune : on y trouve également des métaux farfelus, une organisation de production mondialisée, exigeant des moyens industriels à la portée d’une poignée d’entreprises transnationales, une installation, une exploitation et une maintenance requérant des moyens exceptionnels (barges, bateaux, grues, remorques spéciales…), ne pouvant s’appuyer que sur une expertise fortement centralisée, un réseau de fabrication et de distribution de pièces détachées ultra-techniques, de l’électronique à tous les étages… A mille lieues d’une production autonome, résiliente, ancrée dans les territoires, et maîtrisable par des entreprises et des populations locales.
Peut-on imaginer de maintenir un tel système de production pendant des siècles ou des millénaires ? Naturellement non, pour la même raison que les centrales nucléaires : il faudra bien changer ces grandes éoliennes tous les 30 ou 40 ans, avec l’impossibilité de recycler correctement – c’est-à-dire sans dégradation de l’usage[6] – tous les matériaux, le manque à venir de ressources spécifiques, la dépendance cachée aux énergies fossiles[7] et à l’ensemble de la méga-machine technique.
Reposons notre question : alors à quoi bon se lancer dans un grand programme industriel de renouvelables si l’on sait déjà que le niveau actuel (ou légèrement amendé à coup d’efficacité énergétique) de notre dépense énergétique n’est pas soutenable sur le long terme ? Pour s’acheter du temps, répondrons certains, et se permettre d’organiser la transition. Mais alors pourquoi ne pas organiser plutôt la transition tout de suite ? Cela éviterait de gaspiller des ressources précieuses – énergie et matériaux – dans l’intervalle en continuant à accélérer le système.
Concrètement, qu’est-ce que cela implique ? Prendre la vraie mesure de la transition. Rester simple. Parfois, en faire le moins possible.
Prendre la vraie mesure de la transition, c’est admettre que les formes d’énergie vraiment durables sont sans doute celles basées sur des systèmes moins « agressifs », très locaux et adaptés à leur environnement et de relativement « basse technologie » – afin d’être réalisables, réparables et remplaçables localement – quitte à renoncer à un peu de rendement et de performance : micro et mini hydraulique, petites éoliennes « de village », solaire thermique pour les besoins sanitaires et la cuisson, pompes à chaleur, biomasse…
Las, la quantité d’énergie récupérable par de telles technologies sera bien faible eu égard à nos standards occidentaux. Pas la peine d’espérer faire fonctionner des batteries d’escalators, des trains à grande vitesse ou de gros sites industriels chimiques et électrométallurgiques. Mais si l’on s’organise bien, assez probablement pour vivre décemment[8] et ne pas retourner au lavoir pour faire la lessive à la main. Il faudra par contre monter les escaliers à pied et renoncer aux canettes en aluminium.
Les implications techniques, économiques, sociales, et culturelles sont abyssales. Pour n’en citer que deux, il sera probablement nécessaire de nous « désurbaniser », pour retrouver l’échelle du village et du bourg, car si une petite éolienne sur un toit peut faire fonctionner une machine à laver, elle ne pourra pas fournir le courant à tout un immeuble ! Sans parler du bois de chauffe… Il faudra également penser le ralentissement – sociétal, culturel – pour retrouver le temps nécessaire à un meilleur partage des équipements collectifs et une consommation d’énergie plus basse. Dans les transports et les loisirs naturellement, et, pour rester sur la lessive, parce qu’il faudra peut-être lancer la machine (donc pas trop loin de chez soi) au moment où le vent se lève ! Après tout, à l’époque pas si lointaine des moulins à vent, je suppose que le meunier faisait autre chose les jours de calme plat[9].
Rester simple, car à chaque fois que nous faisons le choix de systèmes plus complexes (pour améliorer le rendement par exemple), plus centralisés, plus mécanisés, plus machinisés (nouvelle frontière de la « productivité » qui vise au remplacement des métiers d’accueil et de service[10]), nous nous éloignons a priori du monde durable et nous rendons plus difficile et plus douloureux le chemin vers la sortie de l’anthropocène. Quelle place demain pour l’informatique, le réseau internet, les télécommunications, tellement enferrées dans l’innovation permanente, la complexité et l’obsolescence programmée ? La réflexion reste à construire, bien au-delà des premiers concepts éthérés du green IT et du Cloud Computing, dont les gains théoriques ont jusqu’à présent été balayés par un phénoménal effet rebond.
Parfois, en faire le moins possible : c’est d’abord de pas nuire, ne pas détruire ce qui peut encore être préservé. Ce serait déjà une vraie révolution, tant nous en sommes éloignés aujourd’hui. L’artificialisation des sols en France emporte la surface d’un département tous les 7 ans ! Et l’on continue joyeusement à bétonner, asphalter ou empierrer, sans doute parfois[11] avec les meilleures intentions (les lignes grande vitesse qui éviteront les déplacements en avion, les plateformes logistiques qui permettront le report modal, etc.)
Ensuite peut-être ne pas s’acharner à « réparer » à tout prix, regarder avec circonspection les réhabilitations de certains sites industriels – quand la dépollution consiste à racler la terre polluée pour aller l’enfouir ailleurs.
Cas emblématique : celui du démantèlement des sites nucléaires. Il est fort à parier d’ailleurs que la plupart ne seront en réalité jamais démantelés, mais uniquement laissés en place[12], devenant nos futurs territoires tabous, quand bien même le montant provisionné à ce jour serait correct[13]. Car là encore, il faut une société riche d’énergie, de matériaux et de technologie pour avoir les moyens matériels d’un démantèlement (cf. l’exemple certes spécifique mais néanmoins hallucinant de Superphénix dont les 3 500 tonnes de sodium désormais radioactif sont maintenues en fusion depuis son arrêt pour être lentement et précautionneusement désactivées en soude). Le jour où il faudra réellement débloquer les sommes provisionnées, c’est-à-dire ni plus ni moins que des octets sur un compte électronique comme signes modernes d’un bon à tirer – malheureusement théorique – sur le travail et les ressources du futur, les moyens humains et matériels feront défaut.
Quelques leçons de l’abolitionnisme anglais
Comment entamer le démantèlement de la méga-machine, et surtout quelles chances de réussite dans un monde tellement imbriqué économiquement et culturellement ? Comment se lancer dans une aventure aussi extravagante que le ralentissement et la relocalisation, alors que l’ensemble du monde accélère et que les échanges s’intensifient ? Inimaginable.
Nous n’aurions alors d’autre choix – encore le coup du There is no alternative – que de mettre en place une gouvernance mondiale, ou à la rigueur européenne, pour se lancer dans l’aventure et amorcer un consensuel et lent virage sur l’aile à la sauce développement durable, dans une version 2.0 qui se voudrait peut-être un peu plus volontariste. On imagine le temps qui serait nécessaire à un tel alignement (cf. les négociations sur le climat), à moins que des catastrophes mondiales convaincantes – ou un Peak Oil particulièrement sévère – ne précèdent l’effondrement, ce qui n’est pas particulièrement souhaitable.
Et si, au contraire, l’alternative était possible ? Afin d’illustrer mon propos, j’aimerais partir de trois éléments tirés de l’histoire de l’abolition de la traite et de l’esclavage en Angleterre[14].
D’abord, l’Angleterre vote, de manière unilatérale, l’abolition de l’esclavage en 1833. Il ne manquait pourtant pas d’économistes et de « décideurs » pour expliquer que cette décision allait grever le budget des plantations et mettre à mal la compétitivité du pays et les petites entreprises familiales[15]. Ensuite, ils appliquent avec constance, dans les décennies suivantes, une diplomatie volontariste fondée sur le bilatéralisme, après avoir renoncé au multilatéralisme inopérant sur le sujet, faisant pression sur les autres Etats, pour les faire plier et voter eux aussi l’abolition. Enfin, ils engagent une force navale dans l’Atlantique, le British African Squadron, pour faire la course aux bateaux négriers et augmenter la pénibilité, donc le coût, du doux commerce triangulaire.
Les historiens pointilleux et les esprits chagrins me pardonneront ces simplifications à la serpe et le passage sous silence de certaines subtilités : que l’émancipation effective fut assortie de nombreuses clauses transitoires et compensatoires pour les planteurs, que ce bilatéralisme forcené était sans doute conduit avec certaines arrière-pensées hégémoniques de l’Empire britannique… Certes. Il n’empêche qu’indéniablement cela a accéléré la fin de l’esclavage, que les sociétés abolitionnistes étaient portées par un véritable souffle humaniste et universaliste, et qu’on ne peut que saluer le courage politique d’un Thomas Clarkson ou d’un William Wilberforce.
Quelles leçons en tirer ? Pourquoi ne pas décider de manière unilatérale (un pays, ou un petit groupe de pays européens par exemple) d’entrer réellement en transition ? Certes de nombreux biens et services sont échangés avec l’ensemble de la planète, mais une large part de l’économie reste cependant nationale, et les échanges avec les pays frontaliers restent majoritaires.
Qu’est-ce qui, foncièrement, nous empêche de revoir dès maintenant les règles d’urbanisme en profondeur, pour mettre fin à l’étalement urbain et réduire les déplacements ? De transformer radicalement notre système de gestion des déchets ? L’installation systématique de composteurs[16], avec un accompagnement d’une partie des éboueurs reconvertis en « conseillers compost », permettrait de réduire le volume de moitié et de rendre des nutriments non pollués aux terres agricoles, tandis qu’on pourrait réduire le reste et recycler très fortement, avec une réglementation volontariste sur l’emballage et les imprimés publicitaires (tout cela sans mettre à mal les finances publiques). De lancer un programme massif de soutien et de conversion à l’agriculture biologique, de remembrement agricole (vive les petites parcelles et les haies), de rééquilibrage des activités de culture et d’élevage ? D’abandonner les stupides programmes de lignes ferroviaires à grande vitesse, d’autoroutes, de routes ? De revoir notre fiscalité pour mieux arbitrer entre main d’œuvre, énergie et matières premières ? De faire évoluer notre échelle des valeurs pour mieux reconnaître socialement l’artisanat et les métiers manuels ? De réorienter drastiquement la recherche publique, l’enseignement ? Objectivement rien.
La puissance d’action de l’Etat et des collectivités, malgré les reculs des dernières décennies, reste considérable. Tant par le volume de leurs achats (pensons aux repas bios dans les cantines ou les administrations, aux prescriptions dans les cahiers des charges techniques des bâtiments…) que par les capacités normatives, réglementaires et législatives (comment se retenir d’interdire purement et simplement ces stupides voyages aériens subventionnés par les comités d’entreprise ou les éclairages de rue à Noël[17] ?)
Bien sûr, en réalité, avec un tel programme, nous mettrions probablement à mal indirectement, par un effet domino difficile à anticiper et à conceptualiser, un certain nombre d’activités économiques. Des entreprises fermeraient ou délocaliseraient[18]. On imagine bien que nos usines de production d’aluminium, par exemple, gourmandes en électricité pour transformer la bauxite importée, auraient tôt fait de s’installer ailleurs si nous stoppons les centrales sans leur offrir l’équivalent gazier (facile) ou éolien (difficile).
Et alors ? Que se vayan todos ! Qu’avons-nous à faire d’une production massive d’aluminium, qui sert aujourd’hui à fabriquer des portières de voiture, des encadrements de fenêtres pour les tours de bureaux et des emballages individuels pour les gâteaux industriels à l’huile de palme ? Nous emballerons nos sandwiches dans un torchon ou une boîte réutilisable au lieu du papier aluminium, et achèterons les yaourts[19] à la crèmerie du quartier, en ramenant nos petits pots en verre[20], voilà tout !
Ce qui compte, c’est de s’assurer que nous gèrerons les conséquences sociales – inévitables – de la transition. Car si nous pouvons voir partir ou disparaître sans hésiter telle ou telle activité nuisible, il n’est pas question de laisser sur le carreau les salariés qui en dépendent. Car c’est bien la défense de l’emploi qui empêche toute radicalité dans l’évolution réglementaire (il faut maintenir les sacs plastiques pour la filière de Haute-Loire) et oblige à toutes les compromissions (avec les pays peu démocratiques acheteurs d’excellence française, matériel militaire ou génie civil par exemple).
Or, prenons à titre didactique la disparition d’une usine de boulons, où de tout autre objet ou service qu’il vous plaira de choisir (engrais, pesticides, armes, automobiles, produits jetables, emballages, services de marketing, de publicité, d’ « évènementiel », etc.) Du jour au lendemain, si nous n’avons plus besoin de ces boulons parce que nous n’en avons plus l’usage (cf. l’aluminium supra), la disparition de l’usine ne change fondamentalement rien aux bornes de la société France : même quantité de nourriture produite, de vêtements, de mètres carrés de logement, etc. Le seul problème – et de taille ! – est que la mise au chômage du personnel vient déformer localement la répartition des richesses, donc leur capacité à consommer ces produits (nourriture, vêtements, logements…) Il suffirait donc de réorganiser cette répartition, par le maintien du salaire à vie grâce à une assurance chômage étendue, ou par la réduction et le partage du temps de travail, sans rien changer à la consommation des autres !
Plus facile à dire qu’à faire, naturellement, mais l’idée générale serait donc de faire décroître la consommation du superflu[21] de pair avec les emplois correspondants, tout en maintenant la cohésion sociale. En parallèle, il est fort à parier que l’évolution souhaitable dans l’agriculture (de plus petites exploitations, plus intensives en travail humain), dans l’artisanat (pour fabriquer et entretenir des biens durables), dans les services (le retour de l’humain contre la machine), devrait être pourvoyeuse d’emplois.
Revenons à nos anglais. Quel pourrait être l’équivalent de leur bilatéralisme forcené ? Il pourrait s’agir par exemple des barrières douanières à l’entrée, sous forme de taxes ou de pressions réglementaires, qui auraient pour effets d’obliger les pays exportateurs à s’aligner, d’une manière ou d’une autre, pour accéder à notre marché, et pour partie de relocaliser la production.
On ne reprochera pas à l’huile d’olive d’être produite là où le soleil est généreux – il serait néanmoins agréable de savoir que celle-ci est produite de manière décente pour l’environnement[22] – mais pourquoi, à terme, les chaussures devraient être produites ailleurs que localement, sauf peut-être dans les pays où les contraintes géographiques ne permettraient pas de produire assez de cuir pour les besoins de la population ?
On pourrait également imaginer très facilement de revoir totalement notre aide au « développement », qui continue à être fondée, malgré un léger vernis vert, sur l’exploitation des ressources locales (ouvrir des routes pour exploiter des mines ou des forêts, construire des barrages pour alimenter des usines, etc.)
Et l’équivalent du British African Squadron, me direz-vous ? Eh bien… sans aller jusqu’à imaginer que notre marine nationale pourrait aller courser les bateaux qui pratiquent la pêche intensive ou en eaux profondes, ou que nos commandos parachutistes pourraient aller réaliser des contrôles environnementaux chez nos fournisseurs étrangers[23], on pourrait imaginer par exemple des pressions sur les compagnies transnationales qui souhaitent exercer des activités en France.
La transition, hic et nunc
Pourquoi attendre donc ? C’est bien ici et maintenant que nous pouvons et devons nous lancer dans la sortie de l’anthropocène, à tous les tempos, à toutes les échelles, locales, régionales, et nationales.
L’entamer dès à présent, commencer à démanteler, pièce par pièce, la méga-machine, avec opiniâtreté, car la route sera longue et sinueuse, c’est de toute manière préparer l’avenir en augmentant la résilience de nos sociétés, leur capacité à encaisser les chocs et les contre-chocs qui ne manqueront pas de se produire régulièrement, dans un monde à court de carburant – l’abondance de l’énergie, des matériaux et des surfaces disponibles – et qui connaîtra donc des soubresauts. Fonder l’espoir d’une sortie de l’anthropocène, c’est aussi ouvrir une perspective différente de celle d’une « crise » sans fin d’un capitalisme à bout de souffle.
Philippe Bihouix
[1] 70 à 100 ans de réserves tout au plus au rythme de consommation actuelle, soit environ deux décennies de visibilité en cas de triplement du parc installé, par exemple, qui était un scénario de développement tout à fait envisagé par l’industrie ou l’Agence Internationale de l’Energie avant Fukushima
[2] A condition d’éviter de crier sur les toits que les ressources ne sont pas infinies là non plus : l’énergie provient de la fusion de deux isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium, mais ce dernier, non présent à l’état naturel, devrait être produit « par exemple » à partir du… lithium – un métal pas particulièrement abondant (2 à 3 fois moins présent que le cuivre dans la croûte terrestre) !
[3] Qui n’est pas un métal mais ne l’empêche pas d’être disponible en quantité limitée
[4] Seulement 3 barils produits pour 1 investi dans les sables canadiens de l’Athabasca, contre 50 pour 1 ou plus dans les champs géants historiques
[5] Il est d’ailleurs étonnant de noter que les mêmes partisans du nucléaire souhaitent enfouir les déchets pour ne pas les exposer, d’ici quelques décennies, à un monde qui deviendra instable et dangereux (voir par exemple l’excellent documentaire Into Eternity, sur le site d’enfouissement finlandais Onkalo). Ce qui n’est pas très cohérent avec l’espoir d’exploiter en même temps cette énergie à grande échelle
[6] Un recyclage avec la possibilité d’une utilisation aussi noble que celle d’origine, ce qui est rarement le cas
[7] Nous avons parlé des métaux ; mais le raisonnement s’applique – encore plus – à tous les matériaux de synthèse issus du pétrole et du gaz (plastiques, polymères…) A moins d’espérer les biosourcer avec la chimie du végétal (en compétition très probable avec les usages alimentaires) ou de transformer les schistes bitumineux (mais nous serons alors rattrapés par la dépense énergétique)
[8] La définition de ce niveau de décence étant bien entendu épineuse et éminemment subjective
[9] Je ne plaisante qu’à moitié… en ayant conscience d’alimenter les craintes du « retour à la bougie » ! On peut espérer néanmoins que des systèmes plus évolués permettront de réduire l’intermittence des sources d’énergie – par exemple la micro-hydraulique, qui n’est qu’un moulin à eau électrifié, ou les générateurs à base de biomasse.
[10] Toute personne ayant mis les pieds récemment dans un bureau de poste comprendra ce que j’entends par là
[11] Au bénéfice du doute, dirons-nous, car il s’agit plutôt de nourrir la méga-machine, les entreprises de travaux et les spéculateurs immobiliers
[12] Eventuellement maintenus hors d’eau pour éviter toute contamination de la nappe phréatique ?
[13] Ce qui fait quand même largement débat, puisque les estimations varient de 200 millions à 3 milliards d’euros par réacteur
[14] Sans oublier toutefois, l’Abbé Grégoire et la première abolition votée en 1794 par la Convention
[15] Comme l’ensemble des progrès sociaux, qui toujours allaient sonner le glas de la compétitivité des entreprises et des territoires : limitation du travail des enfants, semaine de 5 jours, 40 heures hebdomadaires, congés payés… On connaît le refrain, plus que jamais ânonné.
[16] Ou, dans les villes denses, de composteurs à lombric
[17] Pour ne s’en tenir qu’à deux exemples idiots et ne pas verser dans « l’écologie liberticide »
[18] Les esprits retors répondraient à cet argument que c’est ce qu’elles font déjà depuis des décennies. Mais tout est une question de rythme.
[19] Dont il ne vous aura pas échappé qu’ils se sont dotés, vers la fin du siècle dernier, d’un opercule aluminium – plastique grâce à un marketing efficace de nos producteurs d’aluminium locaux
[20] Eh oui, comme autrefois. Je force un peu le trait pour appuyer mon propos, le lecteur l’aura compris.
[21] Précisons à nouveau, dont la définition reste subjective et donnera lieu à d’épineux débats qu’on espère démocratiques
[22] Ce qui disqualifiera donc très rapidement l’huile de palme comme corps gras importé
[23] Quoique l’idée ne soit pas déplaisante, elle pourrait nous attirer certaines inimitiés
MARCHE POUR L’EAU ET LA TERRE SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 à NICE
Rassemblement "Gandhi International" pour le Grand Quart Sud-Est
Venez nombreux-ses et diffusez dans vos réseaux dans tout le sud-est
pour être hébergé sur place envoyez un mail à cristou@nissa.org
LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2012
MARCHE POUR L'EAU ET LA TERRE
CAMINADA PER L'AIGA E LA TERRA
rendez-vous à 14h
devant l'école de la digue des français
Traverse de la digue des français ( proche boulevard Paul Montel )
accès : bus n°9-10-23 arrêt "comté de nice" ou "santoline"
parking Palais Nikaia / Stade Charles Ehrmann / Comissariat boulevard Slama
accès par l'autoroute sortie 51 "saint isidore"
trajet : boulevard Slama / Rond Point Robini / Avenue Sainte Marguerite / St Isidore place du village / Avenue Auguste Vérola / Boulevard des Jardiniers / Rond Point Autoroute / Chemin le long du var / Parking des arboras (Faculté des sports).

Dans le cadre de la Marche organisée par Gandhi International pour l'accès à la terre, qui se traduit par des actions et des événements partout dans le monde en octobre 2012 pour sensibiliser la population et interpeller les décideurs sur l'alarmante appropriation du foncier et la spoliation des paysans du monde entier, un grand rassemblement est organisé dans le Sud-Est de la France sur la plaine du Var à Nice (alpes-maritimes) pour:
-la reconquête des terres fertiles
-la ré-appropriation des ressources en eau
-la défense de nos concitoyens et des générations futures
Cette action est proposée à tous les citoyens d'accords avec la nécessité de, reconquérir les terres fertiles, de se ré-approprier la ressource en eau et de défendre et soutenir nos concitoyens dans cette lutte pour eux, pour nous et pour les générations futurs.
Cette Marche Citoyenne est porteuse d'un message simple : les citoyens doivent décider eux même pour et sur leurs territoires.
Elle est menée en coordination avec l'opération Terra Segurana, dans le soutien aux actions et aux principes.
Les associations sont invitées à être partenaires de cette marche. Il leur est demandé de diffuser dans leur réseau l'annonce de la marche avec ses objectifs tels que rédigés ici et leurs adhérent-e-s / membres sont invité-e-s à y participer en tant que simples citoyens.
La Marche sera suivie d'un grande soirée Festive et Musicale
à la salle des fêtes du Broc (1 place de l'Hôtel de Ville)
avec
Lo Mago d'en Casteu
En Vrac et d'Ailleurs
Grand Con Malade
et
Repas Paysan
à prix libre
avec les légumes de la plaine du var
Renseignements : www.marcheeauetterre.org
Inscription à la marche à inscription_marche@marcheeauetterre.org
POURQUOI LA PLAINE DU VAR ?
L'OIN - Eco-vallée est emblématique des grands projets inutiles et destructeurs pour notre patrimoine terrestre : c'est un projet qui prévoit sur 30 ans l'aménagement de la Plaine du Var sur une surface de 10 000 ha.
La plaine du Var, paradis terrestre méconnu est un lieu qui représente de forts enjeux pour notre avenir à tous.
- Elle renferme une nappe phréatique qui approvisionne en eau potable plusieurs centaines de milliers d'habitants.
- Ce sont les terres les plus fertiles du département qui permettrait d'installer une agriculture productive et de qualité (production locale dans le respect de l'environnement) : la plaine du var fournit trois à quatre récoltes par an
- Au niveau de la biodiversité, c’est une zone très importante, pour de nombreuses espèces d'oiseaux, de plantes, elle est d'une richesse inouïe. Elle a d'ailleurs fait l'objet de classements au niveau européen
Si nous estimons que l’aménagement de la Plaine du Var est une nécessité, nous mettons en doute le projet déclaré, qui amène à exproprier les dernières terres agricoles encore cultivées.
Actuellement personne n'est en mesure de fournir le schéma d'aménagement futur de ces 10 000 ha, les études et prospectives sont faites dans l'opacité totale laissant pour compte les citoyens.
Prenons conscience :
- de la situation urgente que vivent actuellement les premiers expropriés de la Plaine du Var,
- de la disparition croissante des terres fertiles en France, (l'équivalent d'un département par an), et partout dans le monde,
- de la détresse des nombreux agriculteurs qui sont à la recherche de terres pour s'installer : 170 jeunes agriculteurs sont à la recherche de terres !
- De la pollution irréversible de notre ressource en eau et des rivières souterraines parmi les plus pures en Europe. !
- De l'endettement irresponsable que quelques notables contractent dans notre dos : 4 milliards et demi d'euros sur 100 ans : ce sont les générations futures qui continuerons à en payer le prix !
Face à la crise en Europe et dans le monde, il devient indispensable de préserver les dernières terres agricoles au risque d’avoir une vrai crise alimentaire dans un des départements les plus peuplé de France.
A l'exemple de l'opération Terra Segurana, qui représente une action concrète de reconquête de nos terres fertiles et que nous soutenons vivement à travers cette action. Nous appelons tous les citoyens, ainsi que les élus de ce territoire, à prendre leurs responsabilités et à se poser la question de l’avenir que nous voulons pour notre département,notre région, pour les générations futures...
Nous vous invitons à cette grande marche citoyenne!!!
Venez nous rejoindre, venez marcher à nos côtés en tant que simple citoyen pour une nourriture produite localement, saine et accessible dans les Alpes Maritimes, venez cultiver vos légumes, soutenir nos concitoyens expropriés, participer au débat sur l'avenir du projet de l’OIN, pour redéfinir ensemble de nouvelles visions afin d'aborder les défis et enjeux du XXIème siècle.
GRANDS PROJETS INUTILES : LES ALTERNATIVES SONT EN MARCHE !
contact pour se retrouver sur place : Nadège : 0615907209.
Expulsions brutales à Notre-Dame des Landes …. mobilisons-nous !
Une opération d’expulsion d’envergure a eu lieu depuis le matin du 16 Octobre à Notre-Dame-des-Landes avec la participation de 500 à 1500 CRS et gardes mobiles. Plusieurs maisons occupées par les opposants au projet d’aéroport ont été brutalement évacuées. La ferme du Sabot résiste encore.
Les membres de Relocalisons dénoncent ces attaques disproportionnées, coûteuses et inutiles des forces de l’ordre. Nous soutenons les occupants de la ZAD et plus généralement les opposants à ce projet d’aéroport inutile et nuisible qui détruirait plus de 2000 ha de terres agricoles.
Nous vous invitons à soutenir et à participer à toute action de ré-occupation des lieux et de soutien à la lutte en cours.
Plusieurs liens pour plus d’infos sur les prochains rendez-vous et mobilisations :
Les occupant⋅e⋅s de la ZAD : http://zad.nadir.org/
Collectif de lutte contre l’aéroport de Notre Dame des Landes http://lutteaeroportnddl.wordpress.com
Paroles de campagnes Notre Dame des Landes http://parolesdecampagne.blogspot.fr/
ACIPA (Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d’Aéroport de Notre Dame des Landes) http://acipa.free.fr/
CéDpa : Collectif d’élus Doutant de la pertinence de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes http://aeroportnddl.fr/
Egalement …
- Pétition : Notre Dame des Landes oui au débat non aux expulsions
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/dame-landes-oui-debat-expulsions-522.html
Que la justice revienne sur la decision prise contre Kokopelli

Pour proteger la biodiversite contre la main mise toute puissante des grands groupes et lobbies prets a detruire pour servir leur seuls interets, la Justice doit autoriser Kokopelli a vendre des graines anciennes biologiques. Cette action de Kokopelli est noble et il est injuste de l'interdire au profit de massacres generes par les lobbies commerciaux. Merci a la justice de redevenir juste face aux manipulateurs sans scrupules pour qui seul le business a de l'importance. Les graines anciennes biologiques font partie de notre patrimoine precieux et Kokopelli les defend, les preserve, et permet a chacun de les semer. Ceci doit rester notre droit a tous.
Pourquoi c'est important
Pour proteger la biodiversite contre la main mise toute puissante des grands groupes et lobbies prets a detruire pour servir leur seuls interets.
Kokopelli est une association qui distribue des semences anciennes et biologiques dans le but de préserver la biodiversité semencière et potagère. Mais du fait de la pression des lobbys, l’Union Européenne interdit la circulation des semences qui ne sont pas enregistrées dans un catalogue officiel. Le droit de semer est un droit fondamental! Demandons à la France d’agir pour libérer les semences en Europe!
Au camping de la bidouille à Péone
Le 24 août 2012 de Ophelia Noor sur http://owni.fr
Transposez les énergies créatives des bidouilleurs urbains au milieu des montagnes à 1600 mètres d'altitude. Sans eau ni électricité. Laissez mijotez. Hackerspaces et fab labs sont venus planter leurs tentes au festival A Pado Loup pour tester et questionner la pertinence des technologies numériques face aux contraintes naturelles. Et rencontrer d'autres milieux alternatifs DIY, artistiques et écolo.
 L’arrivée se fait par un chemin arpenté et caillouteux, sous un soleil de plomb du 15 août, entouré de montagnes, de pins, de mélèzes et prairies en manque d’eau. Dans un virage, une petite pancarte de bois annonce en rouge : “A Pado Loup”. Le potager accueille le visiteur, puis le garage, et la bâtisse principale. Tout est en bois. Construit avec des matériaux locaux en mode DIY.
L’arrivée se fait par un chemin arpenté et caillouteux, sous un soleil de plomb du 15 août, entouré de montagnes, de pins, de mélèzes et prairies en manque d’eau. Dans un virage, une petite pancarte de bois annonce en rouge : “A Pado Loup”. Le potager accueille le visiteur, puis le garage, et la bâtisse principale. Tout est en bois. Construit avec des matériaux locaux en mode DIY.
L’hôte du festival, Bilou, la cinquantaine énergique est entouré d’une ribambelle d’enfants, cousins, frères, soeurs et amis venus participer et prêter main forte sur l’organisation du festival. Nourriture végétarienne, toilettes sèches, douches solaires, récolte d’eau de pluie, compost, utilisation de panneaux solaires et recyclage des déchets feront partie du quotidien des citadins venus se déconnecter.
Deux ans après les rencontres numériques Estives | Digital Peak, à Péone, hébérgées par Jean-Noël Montagné, fondateur d’Art Sensitif, les équipes du TMP/LAB, TETALAB, USINETTE et des volontaires relancent l’aventure : déplacer les énergies créatives du hackerspace en milieu rural et isolé. Le festival A Pado Loup se tenait du 12 au 22 août à quelques lieues du précédent, près de Beuil dans les Alpes Maritimes, au coeur du parc naturel du Mercantour. Une deuxième édition plus détendue que la précédente, sans la dimension internationale ni l’habituel enchaînement de conférences techniques propres aux rassemblements de hackers, mais avec les mêmes contraintes et objectifs. Loin d’être une expérimentation utopique, les communautés numériques de hackers et autres bidouilleurs sont bien conscientes des enjeux liés aux crises globales : écologique, sociale, politique et énergétique. Le rapprochement avec d’autres milieux alternatifs tournés vers ces mêmes problématiques fait son chemin. En juillet dernier se tenait la deuxième édition du festival Electronic Pastorale en région Centre. Deux ans plus tôt à Péone, Philippe Langlois, fondateur du hackerspace TMP/LAB, posait déjà la question du devenir des hacklabs face à la révolution verte et développait à nouveau cette idée en juin dernier dans une conférence sur les hackerlands donnée au Toulouse Hacker Space Factory (THSF).1
L’innovation dans la contrainte
Les bidouilleurs se retrouvent sous une petite serre aménagée en hacklab pour la durée du festival. Équipée de deux panneaux solaires reliés à une batterie de voiture pour faire fonctionner l’électronique, son équilibre est précaire. Mickaël et Alex du Tetalab, le hackerspace toulousain, ont pris en charge la gestion de l’alimentation électrique et de la connexion WiFi. Le petit hacklab doit rester autonome comme la maison principale.
Le WiFi libre dans les actes
Et si l'accès à l'internet, en mode sans fil, était un "bien commun" librement partagé par tous ? C'est ce que proposent ...
Le challenge ? Ne pas dépasser les 70 watts et garder de l’électricité pour la soirée. EDF ne vient pas jusqu’à Pado Loup, encore moins les fournisseurs d’accès à Internet. Le lieu est en “zone blanche”, ces régions difficiles d’accès et non desservies par les opérateurs nationaux par manque de rentabilité.
Pour assurer une connexion au réseau, une antenne WiFi sur le toit de la maison est reliée à celle d’un voisin quelques kilomètres plus loin. Le relai est ensuite assuré localement par le TETALAB de la maison à la serre des geeks.
Mickael vérifie toutes les heures les installations, tourne les panneaux solaires, et répare les pièces qui ne manquent pas de claquer fréquemment depuis quelques jours. Pendant ce temps, les fers à souder s’échauffent et on bidouille des postes radio FM, pour écouter l’émission quotidienne de 18 heures, point d’orgue de chaque journée. Chacun peut participer, annoncer ou proposer des activités pour la soirée et le lendemain, raconter ses expérimentations en cours. En lieu et place des conférences programmées des Estives, les discussions sont lancés sur la radio du campement.
Fabrication d'une éolienne avec Bilou, le maître des lieux et hôte du festival hack & DIY. - (cc) Ophelia Noor
Chaque jour, une partie du campement passe son temps à trouver des solutions pour améliorer des systèmes déjà en place, produire plus d’énergie avec la construction d’une éolienne, ou en dépenser moins en prenant en compte les atouts du terrain, avec par exemple la construction d’un four solaire. Les contraintes stimulent la créativité et l’expérimentation pour répondre aux besoins de l’homo numericus. Des ateliers sont proposés dans plusieurs domaines, électronique, écologie expérimentale, radio, live coding ou photographie argentique.
Les bactéries, libres et têtues
Sous un arbre avec balançoire, tout au fond de la prairie de Pado Loup, est installée la FFF, la Free Fermentology Foundation, clin d’oeil appuyé à la Free Software Foundation de Richard Stallman. Le hobby de deux chercheurs, Emmanuel Ferrand, maître de conférence en Mathématiques à Paris VII, et Adrienne Ressayre, chargée de recherche en biologie évolutive à l’INRA.
Sur des petits étals de bois, des bocaux où fermentent du kombucha, un thé chinois pétillant réputé pour ses bactéries digestives, des graines de kefir dans du lait ou dans de l’eau mélangée à du sucre et des figues sèches. Et enfin, une potée de riz en fermentation qui servira à fabriquer le makgeolli, un alcool de riz coréen proche de la bière.
(1) Atelier fermentation avec Emmanuel Ferrand et Adrienne Ressayre. (2) Fermentation du riz pour la préparation du magkeolli, (3) morceau de kombucha, (4) dans les pots, kéfir de fruit, de lait, kombucha. Aout 2012 au festival A Pado Loup, Alpes-Maritimes - (cc) Ophelia Noor
Les enjeux, selon Emmanuel Ferrand, sont similaires à ceux du logiciel libre sur la privatisation du vivant :
Les techniques de fermentation ont évolué au cours du temps, elles sont aujourd’hui accaparées par des entreprises qui veulent breveter ces produits déjà existants. La société moderne tend à normaliser les nourritures, et pour des raisons de santé publique en partie justifiées on impose des règles strictes de fabrication, on normalise les pratiques. Avec la FFF nous essayons de faire l’inventaire de ces techniques de fermentations et de préserver celles qui sont plus ou moins borderline ou en voie de disparition – parce que confrontées à des produits commerciaux normés – et de les reproduire.
Tous les matins à 11h, une petite foule se rassemble sous l’arbre à l’écoute des deux chercheurs. On prend le pouls des bactéries, le fromage de kefir, la bière de riz… Après l’atelier fermentation, la conversation dérive chaque fois sur des sujets connexes avec une confrontation stimulante entre Emmanuel le mathématicien, et Adrienne la biologiste : le génome, la pensée réductionniste, les OGM, les mathématiques, la physique, le cancer, les bactéries, le brevetage du vivant.
Des connaissances et des savoirs-faire précieux et ancestraux qui font partie de nos biens communs : “En plus de l’inventaire, nous reproduisons ces techniques ancestrales. Nous partageons nos expérimentations avec d’autres personnes sur le réseaux ou en atelier, comme aujourd’hui à Pado Loup, avec le magkeolli, le kéfir et le kombucha.”
L’écodesign militant
Chacun participe au bon fonctionnement du camp et les tâches ne manquent pas entre la préparation d’un des trois repas, couper du bois pour le feu, ou aller chercher de l’eau potable à la fontaine, deux kilomètres plus bas. Les déchets sont systématiquement recyclés et les restes des repas végétariens sont jetés dans une poubelle spéciale dédiée au compost. Toujours dans le même souci d’utiliser au maximum les ressources naturelles du lieu, Christophe André, ingénieur et designer, proposait deux ateliers d’ecodesign : la construction d’un four solaire et d’une petite maison, sur le principe de l’architecture bioclimatique.
Le jour où on lui a demandé de fabriquer un objet à duré de vie limité, Christophe André a abandonné sa carrière d’ingénieur. Confronté à la tyrannie de l’obsolescence programmée dans les modes de production industriels, il se lance dans des études de design et apprend pendant plusieurs années à fabriquer lui même tous ses objets du quotidien au lieu de les acheter. Il fonde l’association Entropie en 2008. L’idée, proposer un design d’objet sous licence libre à des entreprises, des particuliers ou des collectivités et de rédiger des notices, également sous licence libre, pour diffuser ces savoirs et surtout les fabriquer.
Le four solaire réalisé lors de l'atelier d'ecodesign avec Christophe André, fondateur de l'association Entropie - (cc) Ophelia Noor
La construction du four solaire a nécessité quatre heures de bricolage à une dizaine de participants2. Le four suit le mouvement du soleil, tel un tournesol, grâce à une cellule photovoltaïque coupée en deux par une planche. Sur le principe du cadran solaire, lorsque qu’une partie s’assombrit, un petit moteur, sous une plaque tournante fait tourner le four dans la même direction que le soleil. Un gâteau aux pommes a mis plus de quatre heures à cuire.
Après le repas, lorsque la nuit sans lune recouvre A Pado Loup, un grand feu est allumé. La dizaine d’enfants et les adultes s’y retrouvent pour des jeux, des concerts improvisés. D’autres lancent une projection sonore avec de la musique expérimentale pendant que l’équipe du Graffiti Research Lab part à l’assaut des prairies du Mercantour pour des session de lightpainting3.
La vie la nuit : dans la yourte, le développement photo argentique, les expériences de musique expérimentale, convivialité autour du feu, et atelier lightpainting avec le Graffiti Research Lab. - (cc) Ophelia Noor
De cette seconde expérience, Ursula Gastfall, membre du TMP/LAB, préfère ne pas y penser en termes de pérennisation : “Entre les Estives et APadoLoup, deux ans sont passés. Étant accueillis par des particuliers, nous préférons ne pas faire de plan et pourquoi pas, profiter d’un lieu encore différent la prochaine fois.” L’esprit du hacking, libre et nomade continue de se disséminer dans la nature.
Grenelle de l’environnement : la supercherie écologique [Jean-Christophe Mathias]
 Cet ouvrage est une analyse juridico-politique des lois Grenelle 1 et Grenelle 2.
Cet ouvrage est une analyse juridico-politique des lois Grenelle 1 et Grenelle 2.
Il démontre que ce qui a été présenté comme une opération pour la protection de l’environnement était une manipulation purement électoraliste.
Chronique d’un objecteur de croissance [Serge Latouche]
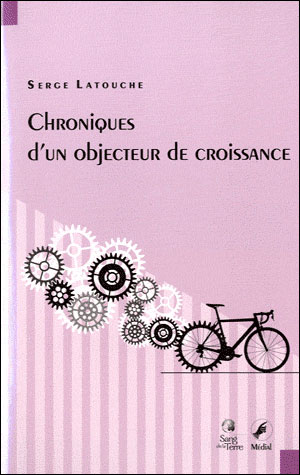 Croissance, croissance, tel est le mot magique prononcé à satiété pour nous sauver des crises qui n'arrêtent pas de se succéder.
Croissance, croissance, tel est le mot magique prononcé à satiété pour nous sauver des crises qui n'arrêtent pas de se succéder.
Décroissance serait un gros mot à bannir, surtout au moment des élections !
Serait-ce la prétention de l'homme de croire qu'il peut exploiter la planète et ses congénères jusqu'à plus soif et qu'il a créé un modèle qui générera toujours plus de richesse, toujours plus de bonheur ?
Pourtant, depuis les thèses de Nicholas Georgescu-Roegen, nous savons que cela n'est pas possible, tandis qu'Ivan Illich et André Gorz nous ont appris qu'un autre schéma de société était possible, qui respecte tout à la fois l'environnement et l'homme.
Serge Latouche défend depuis toujours cette démarche avec pertinence et talent. Ses chroniques, parues dans Politis et revues pour cet ouvrage, nous font prendre conscience de l'urgence et de la justesse de ses analyses.
Il ne s'agit pas seulement d'adapter notre attitude face au dérèglement de notre civilisation, mais il s'agit bel et bien de notre survie.
Pétition : Exploration et exploitation du gaz de schiste (Quebec)
Ici ou labas, le gaz de schiste on en veut pas! Une vidéo québécoise sur le défaut de démocratie dans l'exploitation des Gaz de Schiste, si le Parti Socialiste reouvre le dossier du gaz de schiste alors à nous de le fermer pour toujours.
Texte de la pétition
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’exploration visant à exploiter le gaz de schiste se déroulent au Québec et qu’ils présentent des risques environnementaux importants, notamment pour l’eau en raison des produits chimiques utilisés pour la fracturation ainsi que l’augmentations des GES (gaz à effet de serre);
CONSIDÉRANT QUE des conséquences environnementales de cette exploitation ont eu des effets dévastateurs aux États-Unis et en Alberta;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux soulèvent une inquiétude légitime chez les citoyens et les citoyennes, des communautés ainsi que des élus municipaux qui n’ont pas les pouvoirs d’arrêter ces travaux ou n’ont pas les ressources pour gérer les conséquences de tels travaux;
CONSIDÉRANT QUE le Bureau d'audiences publiques sur l’environnement a reçu un mandat qui se limite à proposer très rapidement un cadre de développement de la filière des gaz de schiste et que pendant ce temps les forages se poursuivent;
CONSIDÉRANT QUE le Québec est actuellement apte à entreprendre un virage vers l’exploitation des énergies durables qui contribuerait à la diminution des GES tout en contribuant à l’emploi et à la richesse collective dans une optique nationale ;
CONSIDÉRANT QU’il est fondamental de décider collectivement de l’exploitation de nos ressources et que l’importance de cet enjeu nécessite une large consultation publique visant entre autres à décider de notre avenir énergétique ;
Nous, citoyens québécois, demandons que le gouvernement provincial du Québec ordonne un moratoire complet sur l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste.
L’impossible capitalisme vert
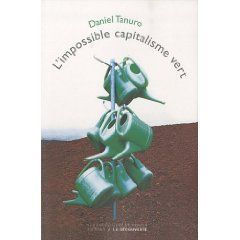 Daniel Tanuro vous êtes l’auteur de L’impossible capitalisme vert, paru aux éditions Les empêcheurs de penser en rond / La découverte. Vous êtes aussi le fondateur de l’ONG « Climat et justice sociale ». Qu’est-ce que le « capitalisme vert » ?
Daniel Tanuro vous êtes l’auteur de L’impossible capitalisme vert, paru aux éditions Les empêcheurs de penser en rond / La découverte. Vous êtes aussi le fondateur de l’ONG « Climat et justice sociale ». Qu’est-ce que le « capitalisme vert » ?
D.T. : L’expression « capitalisme vert » peut s’entendre dans deux sens différents. Un producteur d’éoliennes peut se targuer de faire du capitalisme vert. En ce sens - au sens que certains capitaux s’investissent dans un secteur « propre » de l’économie – une forme de capitalisme vert est évidemment possible et très rentable. Mais la vraie question est de savoir si le capitalisme dans son ensemble peut tourner au vert, autrement dit si l’action globale des capitaux nombreux et concurrents qui constituent le Capital peut respecter les cycles écologiques, leur rythmes, et la vitesse de reconstitution des ressources naturelles. C’est dans ce sens que mon livre pose la question et il y répond par la négative. Mon argument principal est que la concurrence pousse chaque propriétaire de capitaux à remplacer des travailleurs par des machines plus productives, afin de toucher un surprofit en plus du profit moyen. Le productivisme est ainsi au cœur du capitalisme. Comme disait Schumpeter : « un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes ». L’accumulation capitaliste étant potentiellement illimitée, il y a un antagonisme entre le capital et la nature, dont les ressources sont finies. On peut objecter que la course à la productivité amène le capital à être de plus en plus économe en ressources, ce qui se traduit notamment par la diminution observée de la quantité d’énergie nécessaire à la production d’un point de PIB. Mais, d’une part, cette tendance à l’efficience accrue ne peut évidemment pas se prolonger indéfiniment de façon linéaire et, d’autre part, on constate empiriquement qu’elle est plus que compensée par la masse croissante de marchandises produites. Le capitalisme vert est donc un oxymore, au même titre que le capitalisme social.
Ce constat ouvre un débat entre deux conceptions stratégiques opposées. Pour les uns, le fonctionnement spontanément écocidaire du capitalisme peut être corrigé par une action politique dans le cadre du système, en recourant aux mécanismes marchands (taxes, incitants fiscaux, droits d’émission échangeables, etc.). Pour les autres, dont je fais partie, une politique de rupture s’impose au contraire parce qu’une remise en cause des lois fondamentales du capitalisme est absolument indispensable au sauvetage de l’environnement. Il s’agit notamment d’oser contester la propriété privée des moyens de production, fondement du système. A mon avis, le débat entre ces deux lignes est tranché en pratique par l’exemple de la lutte contre les changements climatiques. Dans les pays capitalistes développés, nous sommes confrontés à l’obligation d’abandonner quasi-complètement l’usage des combustibles fossiles en deux générations à peine. Si l’on exclut le nucléaire – et il faut l’exclure - cela implique, en Europe par exemple, de diviser de moitié environ la consommation finale d’énergie, ce qui n’est possible qu’en réduisant dans une mesure non négligeable la transformation et le transport de matière. Passage aux renouvelables et réduction de la consommation énergétique sont liés et nécessitent des investissements importants, inconcevables si les décisions restent subordonnés au dogme de l’efficience-coût. Or, l’alternative à l’efficience-coût ne peut être qu’une planification démocratique axée sur les besoins sociaux et écologiques. Et cette planification à son tour n’est possible qu’en brisant la résistance des monopoles du pétrole, du charbon, du gaz, de l’automobile, de la pétrochimie, de la construction navale et aéronautique,…, car ceux-ci veulent brûler des combustibles fossiles le plus longtemps possible.
Le changement climatique est au centre de votre livre. Vous interprétez ce changement comme étant un « basculement climatique ». Qu’entendez-vous par basculement, et en quoi celui-ci vous paraît-il être autrement plus inquiétant qu’un simple changement ?
D.T. : L’expression « changements climatiques » (il s’agit bien de changements, au pluriel) suggère la répétition de variations climatiques analogues à celles du passé. Or, d’ici la fin du siècle, en quelques décennies, le climat de la Terre risque de changer autant qu’au cours des 20.000 années écoulées depuis la dernière glaciation. Nous ne sommes sans doute plus très loin d’un « tipping point » au-delà duquel il ne sera plus possible d’empêcher la fonte à terme des calottes glaciaires formées il y a 65 millions d’années. Pour décrire cette réalité, le terme « basculement » est indiscutablement plus adapté que celui de « changements » ! La vitesse du phénomène est sans précédent et fait peser une menace majeure, car de nombreux écosystèmes ne pourront pas s’adapter. Cela vaut non seulement pour les écosystèmes naturels mais aussi, je le crains, pour certains écosystèmes aménagés par l’être humain. Voyez ce qui se passe au Pakistan : conçu par le colonisateur britannique en fonction de ses intérêts impérialistes, le dispositif de gestion des eaux de l’Indus par des barrages et des digues qui alimentent un vaste réseau d’irrigation se révèle inadéquat face au risque de crues exceptionnelles. Or, ce risque augmente parce que le réchauffement perturbe le régime des moussons et augmente la violence des précipitations. Il me semble illusoire d’espérer gagner cette course de vitesse en renforçant les infrastructures existantes, comme le proposent la Banque Mondiale et les grands groupes capitalistes spécialisés dans les travaux publics. A l’endiguement des eaux, il serait plus raisonnable d’opposer la gestion souple des crues qui était pratiquée avant la colonisation. C’est ce que propose l’IRN (International Rivers Network) : permettre aux flots d’évacuer les sédiments pour empêcher l’envasement du bassin et alimenter le delta, arrêter la déforestation, ménager des zones inondables, etc. Mais cela demande une refonte complète du dispositif, sur plus de 3000 km, avec des implications majeures sur l’aménagement du territoire, la politique agricole, la politique urbaine, la production énergétique, etc. Sur le plan social, cette refonte, à réaliser en deux ou trois décennies (c’est-à-dire très vite pour des travaux d’une telle ampleur !), implique de remettre en cause le pouvoir de l’oligarchie foncière ainsi que les programmes de développement que FMI et Banque Mondiale imposent par le truchement de la dette. Cette dette doit d’ailleurs être annulée, sans quoi la reconstruction sera lourdement hypothéquée et le pays, étranglé, risquera d’entrer dans l’histoire comme le premier exemple de spirale régressive où le réchauffement global lie entre eux tous les mécanismes du sous-développement et en démultiplie les effets négatifs. On voit bien ici comment les questions sociales et environnementales s’interpénètrent. En fait, la lutte contre le basculement climatique requiert un basculement politique vers un autre modèle de développement, centré sur la satisfaction des besoins des populations. Sans cela, d’autres catastrophes encore plus terribles risquent de se produire, dont les pauvres seront les principales victimes. Tel est l’avertissement lancé par le drame pakistanais.
Vous estimez que les pays du Sud devraient « sauter » l’étape des énergies fossiles pour assurer leur développement et passer directement à celle des énergies renouvelables. Que répondez-vous à ceux qui vous objectent que les énergies renouvelables ne sont pas en mesure (techniquement et quantitativement) d’assurer cette fonction ?
D.T. : Je leur réponds qu’ils ont tort. Le flux solaire qui atteint la surface de la Terre équivaut 8 à 10.000 fois la consommation énergétique mondiale. Le potentiel technique des énergies renouvelables – c’est-à-dire la part de ce potentiel théorique utilisable au moyen des technologies connues, indépendamment du coût – représente six à dix-huit fois les besoins mondiaux, selon les estimations. Il est certain que ce potentiel technique pourrait augmenter très rapidement si le développement des renouvelables devenait enfin une priorité absolue des politiques de recherche dans le domaine de l’énergie (ce qu’il n’est toujours pas actuellement). La transition aux renouvelables pose assurément une foule de problèmes techniques complexes, mais il n’y a pas de raison de les croire insurmontables. Les principaux obstacles sont politiques. Un : sauf exceptions, les énergies renouvelables restent plus chères que les énergies fossiles. Deux : passer aux renouvelables n’est pas la même chose que de changer de carburant à la pompe : il faut changer de système énergétique. Cela requiert d’énormes investissements et ceux-ci, au début de la transition, seront forcément consommateurs d’énergies fossiles, donc générateurs de gaz à effet de serre supplémentaires ; ces émissions supplémentaires doivent être compensées, et c’est pourquoi, dans l’immédiat, la réduction de la consommation finale d’énergie constitue la condition sine qua non d’un passage aux renouvelables qui, une fois opéré, ouvrira de nouveaux horizons. Je le répète : il n’y a pas de solution satisfaisante possible sans affronter le double obstacle combiné du profit et de la croissance capitalistes. Cela implique notamment que les technologies propres contrôlées par le Nord soient transférées gratuitement au Sud, à la seule condition d’être mises en œuvre par le secteur public et sous contrôle des populations.
Vous prônez une écologie sociale que vous appelez l’écosocialisme. Qu’est-ce qu’un écosocialiste ? Et en quoi se différencie-t-il d’un écologiste ou d’un socialiste de « base » ?
D.T. : Un écosocialiste se différencie d’un écologiste en ceci qu’il analyse la « crise écologique » non comme une crise du rapport entre l’humanité en général et la nature mais comme une crise du rapport entre un mode de production historiquement déterminé et son environnement, donc en dernière instance comme une manifestation de la crise du mode de production lui-même. Autrement dit, pour un écosocialiste, la crise écologique est en fait une manifestation de la crise du capitalisme (en n’oubliant pas la crise spécifique des sociétés dites « socialistes » qui ont singé le productivisme capitaliste). Il en résulte que, dans son combat pour l’environnement, un écosocialiste proposera toujours des revendications qui font le lien avec la question sociale, avec la lutte des exploités et des opprimés pour une redistribution des richesses, pour l’emploi, etc.
Par ailleurs, l’écosocialiste se différencie du socialiste « de base », comme vous dites, en ceci que, pour lui, le seul anticapitalisme qui vaille désormais est celui qui prend en compte les limites naturelles ainsi que les contraintes de fonctionnement des écosystèmes. Cela a de nombreuses implications : rupture avec le productivisme et le consumérisme, bien sûr, dans la perspective d’une société où, les besoins de base étant satisfaits, le temps libre et les relations sociales constituent la véritable richesse. Mais aussi contestation des technologies ainsi que des productions nuisibles, couplée à l’exigence de reconversion des travailleurs. La décentralisation maximale de la production et de la distribution, dans le cadre d’une économie démocratiquement planifiée, est une autre insistance des écosocialistes. Un point sur lequel il me semble important d’insister est la mise en cause de la vision socialiste traditionnelle qui voit toute hausse de la productivité du travail agricole comme un pas vers le socialisme. A mon avis, cette conception ne permet pas de rencontrer les exigences de respect accru de l’environnement. En fait, une agriculture et une foresterie plus soutenables écologiquement nécessitent plus de main-d’œuvre, pas moins. Recréer des haies, des bocages, des zones humides, diversifier les cultures, mener la lutte biologique, par exemple, implique une augmentation de la part du travail social investi dans des tâches de maintenance écologique. Ce travail peut être de haute scientificité et de haute technicité – ce n’est pas le retour à la houe – mais il n’est guère mécanisable. C’est pourquoi je pense qu’une culture du « prendre soin » (j’emprunte ce concept à Isabelle Stengers) doit imprégner les activités économiques, en particulier celles qui sont en prise directe sur les écosystèmes. Nous sommes responsables de la nature. D’une certaine manière, il s’agit d’étendre la logique qui est celle de la gauche dans le domaine des soins aux personnes, de l’enseignement, etc. Aucun socialiste ne plaide pour remplacer les infirmières par des robots ; nous sommes tous conscients du fait qu’il faut plus d’infirmières mieux payées pour que les patients soient mieux soignés. Eh bien ! il en va de même, mutatis mutandis, pour l’environnement : pour être mieux soigné, il y faut plus de force de travail, d’intelligence et de sensibilité humaines. Contrairement au « socialiste de base », et même si c’est difficile, l’écosocialiste, parce qu’il est conscient de l’urgence, tâche d’introduire toutes ces questions dans les luttes des exploités et des opprimés, plutôt que de les renvoyer aux lendemains qui chantent.
Beaucoup, dont moi, sont convaincus que la sortie de capitalisme productiviste est une condition incontournable pour lutter efficacement contre le changement climatique.
Pour ce faire, vous en appelez à « l’homme social, les producteurs associés ». Qui sont-ils, et comment peuvent-ils concrètement agir ?
D.T. : Vous faites allusion à la citation de Marx placée en exergue de mon ouvrage : « La seule liberté possible est que l’homme social, les producteurs associés, règlent rationnellement leur échange de matière avec la nature… ». Il faut bien voir que dans l’esprit de Marx, cette régulation rationnelle des échanges est conditionnée par la disparition du capitalisme. En effet, d’une part la lutte de tous contre tous sape en permanence les tentatives des producteurs de s’associer ; d’autre part, une fraction significative des producteurs -les salariés- sont coupés de leurs moyens de production. Ceux-ci, y compris les ressources naturelles, sont appropriés par les patrons. Privés de tout pouvoir de décision, les salariés ne sont pas en mesure de régler rationnellement quoi que ce soit qui concerne la production, pour ne pas parler de régler rationnellement les échanges de matière avec l’environnement ! Pour se constituer en homme social, les producteurs doivent commencer à s’associer dans le combat contre leurs exploiteurs. Ce combat porte en germe l’appropriation collective des moyens de production et l’usufruit collectif des ressources naturelles. Ceux-ci à leur tour sont la condition nécessaire mais non suffisante d’une relation plus harmonieuse avec la nature.
Ceci dit, on peut répondre à votre question sur l’action concrète en examinant comment les différents groupes de producteurs comprennent - ou pas - la nécessité de réguler rationnellement les échanges de matière humanité-nature. Actuellement, il est frappant que les prises de position de type écosocialiste les plus avancées émanent des peuples indigènes et des petits paysans mobilisés contre l’agrobusiness. Ce n’est pas un hasard : ces deux catégories de producteurs ne sont pas, ou pas complètement, coupés de leurs moyens de production. C’est pourquoi elles sont capables de proposer des stratégies concrètes de régulation rationnelle de leurs échanges avec l’environnement. Les peuples indigènes voient dans la défense du climat un argument supplémentaire en faveur de la préservation de leur mode de vie précapitaliste, en symbiose avec la forêt. Quant au mouvement paysan Via Campesina, il a élaboré tout un programme de revendications concrètes sur le thème « les paysannes et les paysans savent comment refroidir le climat ». Par contraste, le mouvement ouvrier est à la traîne. C’est évidemment le résultat du fait que chaque travailleur salarié individuel est amené à souhaiter la bonne marche de l’entreprise qui l’exploite, afin de préserver son gagne-pain. Conclusion : plus les solidarités ouvrières reculeront face à l’offensive néolibérale, plus il sera difficile de développer une conscience écologique chez les travailleurs. C’est un gros problème, car la classe ouvrière, de par sa place centrale dans la production, est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la lutte pour l’alternative anticapitaliste nécessaire au sauvetage de l’environnement. Les peuples indigènes, les organisations paysannes et la jeunesse ont donc intérêt à tenter d’impliquer toujours plus les syndicats dans les campagnes pour le climat, en multipliant les collaborations, les contacts à la base, etc. A l’intérieur même du mouvement ouvrier, il convient de faire émerger des revendications qui répondent aux préoccupations en matière d’emploi, de revenu et de conditions de travail tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un enjeu important à cet égard est la réduction collective radicale du temps de travail, sans perte de salaire, avec diminution drastique des cadences et embauche compensatoire. Un autre volet est l’extension d’un secteur public sous contrôle des travailleurs et des usagers : transports publics gratuits et de qualité, service public de l’énergie, entreprises publiques d’isolation et de rénovation des bâtiments, etc. Les écosocialistes ont un rôle à jouer pour favoriser l’apparition de telles demandes.
Avec L’impossible capitalisme vert vous ne semblez pas craindre d’être taxé de catastrophiste par ceux qui n’ont pas encore compris que nous sommes entrés dans l’ère de l’anthropocène et que l’homme est le principal responsable, notamment depuis l’ère industrielle, de l’emballement climatique. Le capitalisme vert, tout comme « le développement durable » et le « greenwashing », ne participent-ils pas d’une volonté de nier cette responsabilité et de continuer « comme avant » ? La sortie du capitalisme productiviste ne passe-t-elle pas d’abord par une modification de nos comportements de consommateurs et de producteurs ?
D.T. : Je ne suis pas un catastrophiste. Dans mon livre, je me suis basé quasi- exclusivement sur les rapports du GIEC qui, pour ce qui est du diagnostic sur le réchauffement et sur ses impacts possibles, m’apparaissent, quoi qu’on en dise, comme une excellente synthèse de « bonne science », soumise à la peer review. C’est vrai que le GIEC retarde un peu par rapport aux dernières découvertes, mais cela ne change pas grand-chose aux conclusions. En fait, je redoute les discours de panique et de surenchère. Trop souvent, ils tendent à occulter les vraies menaces et les vraies responsabilités. Le basculement climatique se prête bien aux eschatologies, et il ne manque pas de gourous pour clamer que « la planète est en danger », que « la vie est en danger » que « l’humanité est en danger », que le « plafond photosynthétique » va nous tomber sur la tête, ou que sais-je encore. Tout cela est excessif. La planète ne craint rien, et la vie sur Terre est un phénomène à ce point coriace que l’humanité, quand bien même elle le voudrait, ne pourrait probablement pas en venir à bout, même à coup de bombes atomiques… Quant à notre espèce, le changement climatique, en soi, ne la met pas en péril. Le danger qu’il fait planer est plus circonscrit : trois milliards d’êtres humains environ risquent une dégradation substantielle de leurs conditions de vie, et quelques centaines de millions d’entre eux – les plus pauvres – sont menacés dans leur existence même. Les décideurs le savent et ne font rien - ou presque rien - parce que cela coûterait trop cher, et handicaperait par conséquent la bonne marche des affaires. Voilà la réalité toute nue. Trop souvent, les discours catastrophistes ont pour effet d’en voiler la barbarie potentielle, et de diluer les enjeux dans un vague sentiment global de culpabilité : « ne perdons pas de temps à pinailler sur les responsabilités », « nous sommes tous coupables », « nous devons tous accepter de faire des efforts », etc. Pendant ce temps-là, les lobbies énergétiques continuent tranquillement à brûler du charbon et du pétrole à tire-larigot…
Ceci m’amène à la deuxième partie de votre question, concernant le changement de nos comportements de producteurs et de consommateurs. A la suite de ce que j’ai dit plus tôt, il convient de souligner que les salariés sont incapables de changer leurs comportements de producteurs. Qui produit, comment, pourquoi, pour qui, en quelles quantités, avec quels impacts écologiques et sociaux ? au quotidien, seuls les patrons ont le pouvoir de répondre à ces questions et, en dernière instance, ils y répondent en fonction de leurs profits. Les salariés ne peuvent que tenter d’exercer un droit de regard sur la gestion patronale, dans le but de la contester et de prendre conscience de leur capacité de faire mieux, selon d’autres critères que le profit. C’est la dynamique du contrôle ouvrier, et les écosocialistes devraient se pencher sur la manière dont cette vielle revendication peut être revisitée pour englober les préoccupations environnementales.
Pour ce qui est de la consommation, je crois nécessaire de faire la distinction entre les changements individuels et les changements collectifs. A tout prendre, il vaut certes mieux que celui qui voyage en avion compense ses émissions de CO2 d’une manière ou d’une autre, mais cette compensation lui permettra surtout de s’acheter une bonne conscience à bon marché tout en le détournant du combat politique en faveur des changements structurels indispensables. Promouvoir ce genre de comportements, c’est faire le jeu du « greenwashing », et celui-ci vise effectivement à « continuer comme avant ». Autre chose sont les changements collectifs qui concourent à valider une autre logique possible, favorisent l’invention de pratiques alternatives et contribuent à la prise de conscience que des changements structurels sont nécessaires, qui passent par une mobilisation sociale. Ces changements-là, tels que les groupements d’achat de produits bio auprès des agriculteurs, ou les potagers urbains collectifs, sont à encourager.
Peut-on lutter contre le basculement climatique sans tenir compte des coûts financiers et sociaux que cela représente ? Y-a-t-il urgence à bâtir un autre modèle et à risquer de mettre en péril la société toute entière ? Entre Nature et civilisation, quel choix ?
D.T. : Dire qu’une autre politique climatique mettrait la société toute entière en péril au nom d’une priorité de la Nature sur la civilisation, c’est mettre la réalité sur sa tête ! Ce qui se passe en vérité, c’est que la politique actuelle met la civilisation en péril tout en causant d’énormes dommages irréversibles à la Nature, qui est notre patrimoine commun. Cette politique est totalement subordonnée au dogme de l’efficience-coût, et on voit ce que ça donne : des peanuts. Nous allons droit dans le mur. Evidemment, une autre politique ne pourra pas faire comme si le coût des différentes mesures à prendre n’avait aucune espèce d’importance : entre deux stratégies équivalentes pour réduire les émissions, il est raisonnable de choisir celle qui, toutes autres conditions étant égales, coûtera le moins cher à la collectivité. Mais le fond de l’affaire qu’il faut d’abord une autre politique, guidée par d’autres critères que le coût, notamment des critères qualitatifs. Sur le plan technique, un critère essentiel est celui de l’efficience énergétique au niveau des filières. Le grand écologiste américain Barry Commoner plaidait déjà cette cause il y a plus de vingt ans. Il est thermodynamiquement absurde, disait-il, de transporter du charbon sur des milliers de kilomètres pour produire de l’électricité qui, une fois acheminée sur des centaines de kilomètres, servira à chauffer de l’eau sanitaire, chose que l’on peut très bien faire avec un chauffe-eau solaire. Sur le plan social, un critère majeur doit être la protection des populations et de leur bien-être, en particulier la protection des plus pauvres. Ce critère, aujourd’hui, est très largement ignoré, d’où le drame du Pakistan, entre autres.
Enfin, pensez-vous que votre projet écosocialiste soit réalisable dans un avenir proche ?
D.T. : La possibilité de réaliser ce projet dépend entièrement des rapports de force entre le capitalisme d’une part, les exploités et les opprimés d’autre part. Ces rapports de force sont actuellement à l’avantage du capital, il ne faut pas se le cacher. Mais il n’y a pas de troisième voie possible : les tentatives de sauver le climat par des mécanismes de marché étalent tous les jours leur inefficacité écologique et leur injustice sociale. Il n’y a pas d’autre chemin que celui de la résistance. Elle seule peut changer les rapports de forces et imposer des réformes partielles allant dans la bonne direction. Copenhague a été un premier pas, le sommet de Cochabamba un second. Continuons à marcher, unissons-nous, mobilisons-nous, construisons un vaste mouvement mondial pour le sauvetage du climat dans la justice sociale. Ce sera plus efficace que toutes les démarches lobbyistes de ceux qui se font des illusions sur le capitalisme vert.
SOURCE
http://www.ecologitheque.com/itwtanuro.html